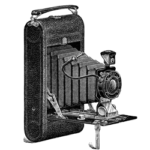La vie de Bziridzi, une petite hirondelle parisienne qui ira jusqu’au bout du monde…
Source : Gallica
AVENTURES D’UN PETIT OISEAU
I
L’ENFANCE DE BZIRIDZI
Je suis née sur les hauteurs de Sainte-Geneviève, au coin de la deuxième fenêtre droite de la façade nord de la Bibliothèque de ce nom, où ma famille avait, de père en fils, établi son nid. Je suis donc Parisienne, et j’avoue que ressens quelque orgueil de ma nationalité. Quant à mon nom, mes parents me donnèrent celui de Bziribzi qui, en gazouillis ou langage d’hirondelle, veut dire Vole-au-vent. C’était, sans doute, une allusion à la grâce et à la légèreté dont je fis montre, parait-il, dans mes premiers essais de navigation aérienne.
Depuis ce temps, j’ai traversé bien des mers, vu bien des pays ; mais je n’ai gardé au fond du cœur aucun souvenir plus cher que celui de mon enfance et de ma jeunesse passées à Paris.
Je revois encore notre bon vieux nid de famille où, avec mes quatre frères et sœurs, j’ouvris pour la première fois les yeux aux gais rayons d’un soleil de mai. On y était si bien, si chaudement, dans ce vieux nid, grâce à la sollicitude de nos bons parents !
C’était une véritable bâtisse, élégamment façonnée, solidement construite, aux parois bien sèches, et sans aucune aspérité qui pût nous blesser. À l’envi mon grand-père et ma grand’mère avaient amassé, pour l’édifier, du duvet, des brins de foin et de paille ; le tout avait été mêlé, puis pétri avec une espèce de ciment fait de terre gâchée qu’ils travaillaient avec leur bec, en guise de truelle.
J’ai ouï-dire que les hommes citaient nos nids d’hirondelles comme de véritables merveilles. On nous fait, parait-il, l’honneur de nous considérer comme de bons architectes, on vante la solidité de nos demeures aériennes ; elles acquièrent, dit-on, la dureté de la pierre, et il faut, pour les méchants qui les détruisent, l’aide du marteau.
Mais que de peines ne nous donnent-elles pas pour les construire ? J’ai entendu réciter par un petit écolier de mon quartier une pièce de vers que l’on apprend aux enfants ce que nous coûte un nid et le respect qu’ils lui doivent. Puissent-ils bien comprendre et ne jamais oublier la leçon contenue dans ces vers :
« Savez-vous ce que coûte un nid ? »
À son fils disait une mère.
— Oui, maman, vous me l’avez dit :
Un nid se fait d’un peu de terre,
De crins, de feuilles, de fougère,
Du duvet qui pend au buisson ;
Ne sais-je pas bien ma leçon ? »
— « Et puis encore ? » — « Plus rien, je pense ! »
Par là fredonnait un pinson.
« Mon fils, écoutez sa chanson ! »
— Du temps, beaucoup de patience ;
De soins, plus encor de prudence,
Pour savoir bâtir sa maison,
À l’abri des mains de l’enfance,
Si contre elle il est un abri ;
Aller, venir, à force d’aile,
Et de tendresse maternelle ;
Saviez-vous, mon petit ami,
Saviez-vous ce que coûte un nid ? »
Pour nous abriter de l’air frais de la nuit et empêcher toute agression hostile, l’ouverture, à la fois porte et fenêtre, et tout juste suffisante pour laisser passer l’une de nous, avait été pratiquée à la partie supérieure du nid.
C’est là, dans le voisinage d’un bon vieux savant penché toute la journée sur son grimoire, que je suis venue au monde et que j’ai passé ma première enfance.
J’ai gardé le souvenir d’un épisode dramatique de cette époque, ses détails comiques et son lugubre dénouement me resteront toujours dans la mémoire.
Un ménage voisin du nôtre avait trouvé, paraît-il, de retour à Paris, son nid occupé par un moineau impertinent qui, plutôt que de se construire lui-même une demeure, avait imaginé de s’emparer de celle d’autrui. À toutes les remontrances des propriétaires cet impudent personnage répondait que la place était au premier occupant. Il fallut employer la force pour jeter cet intrus à la porte. Mais l’architecture de nos nids facilite merveilleusement la défense à l’assiégé, et le madré pierrot (cette engeance est sans vergogne) se cantonna si bien chez lui et y fit une si rude résistance, que nos voisins, désespérant d’en venir seuls à bout, appelèrent à l’aide. Ils eurent recours à nos parents et à d’autres couples d’hirondelles pour mettre l’intrus à la raison. Vous savez, sans doute, que c’est chez nous une tradition respectée et suivie, que nous venions mutuellement à l’aide et au secours de celles d’entre nous qui en ont besoin. En rangs serrés on se précipita à l’assaut du nid usurpé. Le ciel retentit de nos cris ; les habitués de la Bibliothèque Sainte-Geneviève coururent aux fenêtres pour savoir ce qui se passait ; le vieux savant, occupé à traduire un livre sanscrit, en fit, assure-t-on, un contre-sens. Rien n’y fit. Le pierrot, arcbouté sur ses pattes, l’œil en feu, les plumes de la tête hérissées, rageur, furieux, ripostait par de terribles coups de bec.
De guerre lasse, nos parents se retirèrent avec les propriétaires pour délibérer.
Malgré que notre race ne soit pas méchante, il fut résolu que l’on donnerait au voleur une leçon qui, pour lui, serait la dernière, mais qui profiterait aux siens. On décida de le murer dans la maison volée.
Peut-être chez les hommes y a-t-il ainsi des conquérants à qui leurs conquêtes ne profitent guère et qui leur serviront un jour de tombeau.
Ce fut le sort du malheureux moineau. À un signal convenu, toute la troupe des hirondelles, le bec bien garni de terre glaise, fondit sur le nid, et, en un clin d’œil, la porte fut bouchée.
J’étais bien jeune alors, mais il me semble que j’entends encore les cris d’abord furieux, puis désespérés, du moineau à qui manquaient soudain l’air et la lumière. Puis, plus rien ! Il était enterré vivant, et les architectes vengeurs auraient pu mettre sur le nid cercueil, pour servir de leçon aux autres : Mort aux voleurs ! »
Quelques jours plus tard, encouragées, soutenues par nos parents, nous faisions le premier essai de nos ailes.
Quelle terreur ! Quoi ! Du haut de la Bibliothèque Sainte-Geneviève se jeter ainsi dans le vide, au risque de s’écraser sur le pavé ! C’est notre destinée pourtant, et il fallait bien obéir à notre père.
— Allons, petite, ouvre les ailes, disait-il un peu rudement ; tu trembles, je crois ? Quelle poule mouillée !
— Patiente, mon ami, intercédait ma mère ; c’est l’émotion. On n’est pas maître de cela !
— Bah ! Je te dis que ce n’est qu’une peureuse ! Madame, auriez-vous couvé quelques œufs d’hirondelle de cheminée ? Allons, il faut en finir !
— Non, répliquait ma pauvre mère anxieuse, ne la rudoie pas ! Laisse-moi faire, tout ira bien.
Et de me soutenir de l’aile et du bec.
Dieu me pardonne ! Je crois qu’alors mon père, naturellement plus porté aux résolutions énergiques, me donna par derrière une vigoureuse poussée qui me lança dans l’espace. Mais au fond il tremblait tout comme ma mère, et j’ai su, depuis, qu’il avait pris toutes les mesures pour me rattraper au vol en cas de catastrophe.
Il ne lui fallut pas en venir là.
Ivresse ! Ivresse ! Je nageais dans l’azur fluide, je fendais l’air impalpable, j’étais baignée de soleil ! Le mouvement accéléré de mes ailes rendait mon sang plus ardent ; il me semblait que je vivais dix fois, qu’il y avait en moi dix hirondelles. Les hommes ne doivent pas connaitre cette sensation, même lorsqu’ils sont entraînés au ciel par ces énormes sphères plus légères que l’air. Je les plains.
Dès lors j’étais oiseau, j’avais fait mes preuves, et je fus aussitôt associée aux courses et aux parties de chasse de ma famille. Il fallait voir comme mon bec s’ouvrait, se refermait, s’ouvrait encore pour happer sans cesse, dans notre vol circulaire, les moucherons, les cousins, les charançons et les myriades d’insectes presque invisibles à d’autres yeux que les nôtres, qui flottent dans l’air et dont l’atmosphère est comme saturée dans les chaudes journées d’été.
Notre vie est une chasse perpétuelle, un repas sans fin, un bercement éternel. Les distances, nous ne les connaissons pas : nous déjeunons en Europe et dînons en Afrique. Et c’est Dieu qui nous a confié la mission d’épurer ainsi sans cesse les plaines du ciel, de nettoyer l’atmosphère des nuées d’insectes qui, sans nous, se multiplieraient à l’infini et arriveraient à dévorer l’homme, après l’avoir affamé, et à faire de la création une solitude.
Les enfants des hommes ne devraient pas l’oublier.
II
UN ÉTÉ DANS LES ALPES
Vers les derniers jours de juin, comme nous allions avoir deux mois, nos parents résolurent de nous faire voir du pays et de nous emmener passer le reste de l’été dans les Alpes. D’ailleurs ce n’était pas seulement pour notre agrément que ce voyage nous était offert ; fidèle à l’instinct que la Providence nous a donné, père voulait par là nous aguerrir, nous fortifier et nous mettre en mesure de résister, quand il le faudrait, aux fatigues d’une longue traversée. C’est ce que les hommes appellent, je crois, l’entrainement. Pour nous entraîner, nous devions gagner la Suisse en une seule étape. De Paris aux Alpes, ce n’est qu’un jeu pour nous.
Les hommes, en effet, se font difficilement une idée de l’aisance avec laquelle nous évoluons dans les airs. Ils se demandent, sans doute, comment, à volonté, nous nous élevons, nous retombons, pour nous élever encore d’un seul coup d’aile. Est-il rien de plus simple, cependant ?
Nos grandes ailes en faulx nous servent de rames pour frapper sur l’air qui nous environne et nous porte ; notre large bec, constamment ouvert, aspire à longs traits des quantités d’air suffisantes pour pénétrer jusqu’aux dernières cavités de nos poumons, et cet air même nous rend plus légères. Mais il y a plus : nos poumons sont enveloppés d’une membrane percée de grands trous qui distribuent l’air aspiré dans les cavités de la poitrine, de l’abdomen et même jusque dans nos os. Le tissu de nos os est si serré, si compact que, sous un moindre volume, il offre une bien plus grande solidité. Au lieu de renfermer de la moelle, comme chez les autres animaux, ils sont chez nous remplis d’air. L’air est donc autour de nous, au-dessous de nous, en nous. Il est aisé de comprendre dès lors comment tout notre organisme tend à diminuer notre pesanteur, et comment, à notre gré, nous devenons plus lourdes ou plus légères que l’air. Il nous suffit pour cela d’emmagasiner dans nos réservoirs plus ou moins de cet air même. Voulons-nous devenir légères ? Nous enflons notre volume et diminuons, par conséquent, notre pesanteur relative. Voulons-nous alourdir et redescendre ? Nous chassons l’air de notre corps et redevenons aussitôt plus pesantes. Nous sommes donc à la fois vaisseaux et ballons ; nos ailes sont nos rames, notre queue notre gouvernail ; notre bec nous sert de proue pour fendre l’océan atmosphérique, et l’air forme le lest, que nous prenons ou jetons à volonté.
Ajoutez à cela que la nécessité de poursuivre sans cesse une proie ténue et fuyante nous enseigne merveilleusement tous les mystères et tous les caprices du vol.
Aussi, quoique bien jeunes encore, nos parents n’hésitèrent pas à nous faire entreprendre ce premier voyage.
D’autres familles partaient avec nous. Nous composions ainsi une véritable caravane de touristes qui allions chercher dans les montagnes, avec un air plus pur que celui de Paris, un peu de fraîcheur et une nourriture plus variée. Au signal donné, la petite troupe ailée poussa de grands cris et s’élança vers le sud.
Quelle joie pour de jeunes hirondelles ! Aller vers l’inconnu ! Quitter nos hauteurs de Sainte-Geneviève ! Voir du nouveau ! Quelles exclamations bruyantes tout le long de la route !
Les unes chantaient en gazouillis, qui est notre langue, ce que le poète a essayé de traduire en la sienne :
Des ailes ! des ailes ! pour voler
Par montagne et par vallée !
Des ailes pour bercer mon cœur
Sur le rayon de l’aurore
Des ailes pour planer sur la mer
Dans la pourpre du matin !
Des ailes au-dessus de la vie !
Des ailes par delà la mort !
RÜCKERT
Les autres disaient en chœur notre hymne national, dont voici la traduction en langue barbare :
« Louange à Dieu !
« Nous sommes les voyageuses du ciel, les messagères du printemps ! En nous jouant, nous volons des coupoles dorées de l’Orient aux blancs minarets de l’Algérie. Nous établissons nos demeures, à notre gré, dans les pagodes sculptées de l’Inde ou sur les mosquées étincelantes qui se mirent dans les flots bleus du Bosphore !
« Louange à Dieu !
« Nous sommes les filles du soleil !
« Notre Œil reconnaît là-bas, tout là-bas, la fenêtre hospitalière où nous avons suspendu notre demeure aérienne.
« Nous y saluons d’un bonjour ami la jeune fille qui, l’an passé, avait attaché à notre patte le ruban de soie verte, symbole de l’espérance, gage de notre retour !
« Louange à Dieu !
« Nous sommes les filles de l’air !
« Nous apportons la bénédiction du ciel sur le toit aimé où l’on nous fit bon accueil. C’est nous qui sommes les oiseaux du bon Dieu ! Les méchants mêmes nous respectent. Les autres habitants des airs ne nous font pas la guerre, car nous sommes les hérauts du printemps ! »
Le soir même, nous étions arrivées dans les Alpes de Savoie, dans la jolie petite ville d’Annecy.
Quel air pur sur les hauteurs ! Ici les eaux sont bleues comme le bleu du ciel. Quelles délicieuses parties de chasse n’avons-nous pas faites, à la poursuite des moucherons et des phalènes, tantôt en rasant de l’aile l’azur limpide du lac qui reflétait notre vol, tantôt en planant sur les sommets rosés de la Tournette, du Semnoz, du Parmelan ! Le soir, nous poursuivions les insectes sous les taillis qu’embaument les senteurs des cyclamens ; le matin, nous nous envolions pour une excursion de l’autre côté des Alpes, au pays où la neige éternelle flamboie au front du Mont-Blanc, sous les rayons du soleil de septembre.
Nous aimons, nous autres hirondelles, ces beaux pays où c’est toujours en amies que l’on nous accueille, et que nous connaissons bien, à force de les traverser, quand nous émigrons vers l’Orient. N’est-ce pas à Annecy que le bon saint François de Sales, interrompu dans son sermon par les gazouillements indiscrets de nos ancêtres, s’arrêta, un jour, pour leur dire avec douceur : « Hirondelles, mes sœurs, ne pourriez-vous pas faire un peu moins de bruit ? »
Hélas ! c’est aussi dans les Alpes de Savoie que devait nous arriver la série de catastrophes qui termina d’une façon si lugubre ce voyage d’agrément.
La première victime fut mon malheureux père. Un soir de fête, le 14 juillet, je crois, comme on avait allumé une sorte de petit soleil lumineux au bout d’une tige de fer, surpris par cette clarté subite, fasciné peut-être, mon père se précipita sur cette flamme et retomba à terre, les deux ailes brûlées.
Une hirondelle qui n’a plus ses ailes est une hirondelle perdue. Mon père le sentait ; il mourut de douleur plutôt que de sa blessure.
Ce n’était que le commencement de nos malheurs. Notre plus jeune frère, Flèche-de-la-Nue, fut dévoré par un chat ; des enfants réussirent à prendre une autre de nous qui mourut d’inanition entre leurs mains, après deux jours de captivité. C’est ce qui inspira à un poète ces vers :
LA MORT DE L’HIRONDELLE
Qu’ils sont gais, les enfants ! Ils ont pris l’hirondelle
Qui sous l’obscur fenil avait bâti son nid.
La mort t’est réservée, hôtesse trop fidèle !
Pauvre oiseau, tes instants sont comptés ; sois puni !
Quelle prison, d’ailleurs, semblerait digne d’elle ?
La cage, qui nageait dans l’azur infini !
La cage, à qui franchit Paris en trois coups d’aile !
Tu ne gazouilles plus, ton plumage est terni !
« Elle ne mange pas, dit l’un ; quelle méchante !
Moi, dit un tout petit, moi je veux qu’elle chante !
« Il faut la délivrer de sa captivité ! »
Ils déposent l’oiseau sur la fenêtre ouverte.
Trop tard ! Devant les cieux et la campagne verte
Il bat le sol de l’aile… Il est en liberté !
Une autre de mes sœurs ne revint pas, le soir, au nid de la famille ; nous n’avons jamais su ce qu’elle était devenue.
De sept que nous étions parties de Paris, nous étions donc réduites à trois : ma mère, ma sœur et moi. Et voici que subitement, cette année-là, un froid rigoureux nous surprit avant l’époque accoutumée. Il neigea toute une nuit, et je me souviens que nous entendions les moineaux, ces éternels raisonneurs, se plaindre de ce que la saison qui mettait sur la terre une belle nappe blanche leur enlevât aussi leur repas.
Notre mère, inquiète, désolée par la perte des siens, se sacrifia pour nous. Les insectes manquaient ; pour ne pas nous disputer notre pâture, elle se laissa mourir de faim. D’ailleurs la première gelée l’avait transie, et, depuis ce temps, elle ne s’était pas rétablie. Elle mourut entre nous deux, sur la corniche d’une église, tandis qu’au-dessus de nous les corneilles croassaient à tue-tête : « C’est l’hiver ! C’est l’hiver ! »
« Vite, en Orient, mes filles, en Orient ! » ce furent les dernières paroles de notre mère.
L’approche menaçante de l’hiver nous faisait une loi de leur obéir sans délai.
Le cœur navré à la pensée de ceux des nôtres que nous laissions là, nous partîmes donc, ma sœur et moi, pour aller… où le père nourricier des oiseaux leur ordonne de se rendre.
III
EN AUSTRALIE !
Ce fut une bonne mère hirondelle, amie de nos parents, qui, fidèle à leur mémoire et docile nos instincts de sociabilité, remplaça pour nous la Providence, acheva notre éducation et se chargea de nous conduire vers des climats plus chauds.
« Mes petites, nous dit-elle, assez pleuré pour le moment ! Il faut songer au départ. »
Ce matin-là, toutes nos sœurs — elles étaient bien vingt mille, — se donnèrent rendez-vous sur les fils télégraphiques, sur les corniches des édifices les plus élevés. Quelle immense brochette de petits ventres blancs, de gorges rouges, d’ailes noires ! Puis, à un signal donné, au milieu de clameurs assourdissantes, de babillages sans fin, nous nous élançâmes toutes dans la direction du Midi.
Bientôt nous apprîmes que nos guides nous conduisaient en Australie et que nous traverserions le canal de Suez. C’était simplement un voyage de 3,850 lieues marines que nous commencions ainsi, sans hésiter, sans trembler. Si jamais ces mémoires, écrits en gazouillis, sont traduits en langage humain et tombent sous les yeux de jeunes lecteurs, ils sauront que ce chiffre équivaut à environ 4,840 lieues terrestres. N’y a-t-il pas là de quoi faire frémir des ailes encore novices ? Mais sait-on que, lorsque nous n’avons pas à lutter contre des vents contraires, nous pouvons faire jusqu’à 130 kilomètres à l’heure, c’est-à-dire, en dix heures de vol, 1,300 kilomètres ? Avec cette vitesse on peut voir bien du pays.
Cependant ce n’est pas, comme on pense, sans de terribles sacrifices que nous parvenons alors au but de notre navigation aérienne. Combien d’entre nous, accablées de lassitude, exténuées par la faim, endolories par les premiers froids de la nuit, ne devaient pas achever leur voyage, et ne devaient avoir d’autre tombeau que les flots bleus de la Méditerranée ou de l’Océan Indien !
On nous a dit qu’un poète s’était demandé, un jour, ce que devenaient les oiseaux morts, dont on ne retrouve jamais les restes. Hélas ! pour nous, hirondelles, nous ne savons que trop ce que deviennent celles d’entre nous qui succombent au cours de nos migrations ; leurs cadavres servent de pâture aux poissons marins.
Le soir, quand nous étions trop épuisées, si notre bonne fortune nous faisait rencontrer des navires qui suivissent la même route que nous, nous nous abattions, pour demander l’hospitalité d’une nuit, sur les vergues et les cordages. Là nous reposions nos ailes, nous happions à la hâte le maigre souper que nous fournissaient les moucherons et les insectes de toutes sortes qui suivaient le vaisseau, et nous nous endormions jusqu’au lendemain, bercées par le roulis, sous la protection des matelots, qui nous accueillent amicalement et nous respectent comme des hôtes qui leur rappellent leur pays.
Nous arrivâmes enfin en Australie, dans cet empire de l’or et de la verdure.
Le souvenir que j’ai gardé de cet étrange pays est trop présent à ma mémoire pour que je n’en parle pas ici.
Pays étrange, en effet, et qui nous réservait bien des surprises, par comparaison de ce que nous avions vu en Europe. En Australie, on trouve des fleurs magnifiques, riches en miel, mais sans parfum ; des orties et des fougères de la grandeur du chêne ; de grandes forêts croissant dans le sable pur, mais qui ne donnent ni ombre ni fraîcheur ; des arbres dont le bois résiste à l’action du feu ; d’autres qui changent d’écorce suivant les saisons, tandis que leurs feuilles demeurent toujours sur les branches ; certains fruits qui ressemblent à des poires, mais qui pendent à l’arbre par la partie la plus large du fruit ; d’autres qu’on a comparés à des cerises qui auraient la chair en dedans et le noyau en dehors.
Quant aux animaux, ils sont plus singuliers encore. La grande majorité des quadrupèdes de l’Australie sont des marsupiaux ou animaux à poche, comme le sarigue ; d’autres portent un bec comme des oiseaux ; on y trouve des chiens, mais ils n’aboient pas comme les autres : la plupart des oiseaux ont un plumage magnifique, seulement ils sont privés du chant ; plusieurs, au lieu de langue, ont une sorte de pinceau qui leur sert à lécher sur les fleurs le miel dont ils se nourrissent. Le cygne et le kakatoès, blancs partout ailleurs, y sont noirs ; l’aigle et le rouge-gorge, au contraire, y sont blancs.
Nous visitâmes les principales villes : Sydney, Melbourne, Adélaïde, sans compter quelques parties de chasse dans la Nouvelle-Zélande.
Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, est aussi la vieille capitale de toute l’Australie. C’est une ville de 250,000 habitants, dont les rues sont belles et dont les seuls monuments sont des banques, des églises catholiques et anglicanes, et aussi le Town-Hall, c’est- à-dire la mairie, la maison commune.
Ce qui rend pour nous, hirondelles, le séjour de cette ville très agréable, c’est que ses rues sont sillonnées de fils télégraphiques et téléphoniques qui nous servent de reposoir. La nuit, les jardins, les squares, qui sont fort beaux, sont éclairés à la lumière électrique. Les peuples de l’Occident ne sont pas encore arrivés à ce degré de luxe et de progrès.
Melbourne, avec ses 300,000 habitants, est encore plus intéressante. Nous volions à perte d’haleine dans ses avenues immenses, et c’était pour nous un spectacle amusant de voir circuler au-dessous de nous les « cars à ficelle » ou « cable tramway, » sans que nous pussions distinguer toutefois quelle force les faisait mouvoir. C’est, paraît-il, un câble en fer souterrain et mis en mouvement par des machines situées aux deux extrémités du parcours.
Pour Adélaïde, où nous ne séjournâmes que quelques semaines, c’est une ville de 60,000 habitants, dont les environs me rappelèrent par leur caractère riant les environs de Paris, ma ville natale, mais dont les vignes et les oliviers font songer au midi de la France. Ce qui ajoute encore à l’étrangeté du paysage, c’est qu’on y voit circuler de nombreux chameaux, qui, dit-on, y ont été importés pour servir à traverser les vastes déserts de l’Australie.
Si j’entreprenais, d’ailleurs, de raconter toutes les surprises que le continent australien réservait aux plus jeunes d’entre nous, je n’en finirais pas.
L’arbre caractéristique de ce pays est l’eucalyptus, qui atteint parfois jusqu’à 60 mètres de hauteur et 1 mètre 50 centimètres de diamètre. Ses feuilles semblent suivre le soleil et, de loin, elles donnent au paysage cette couleur bleuâtre d’où les « Montagnes-Bleues » ont tiré leur appellation.
Ce qui nous étonnait beaucoup aussi, nous autres jeunes hirondelles, dans les premiers jours qui suivirent notre arrivée, c’était de voir, en certains endroits, comme deux forêts pour ainsi dire superposées. Les plus vieilles d’entre nous nous expliquèrent que c’était l’effet d’un mélange d’arbres différents, figuiers sauvages et eucalyptus. Ces derniers, d’une taille et d’une élévation prodigieuses, s’élançaient bien au-dessus des figuiers et formaient, dans le sens de la hauteur, deux couverts à grande distance l’un de l’autre.
Parmi les principaux marsupiaux ou animaux à poche, comme je l’ai déjà dit, à cause de la poche qu’ils portent sous le ventre et qui sert à abriter leurs petits, les plus étranges sont les wallaly ou kanguroos, les opossums, le devil, carnassier féroce qui tue pour le plaisir de tuer.
Mais le plus extraordinaire de tous les hôtes des forêts australiennes, c’est bien l’ornythorhynx. Quelle singulière bête ! Elle a le dos d’un lapin, le bec d’un canard, les pieds de devant palmés comme ceux de l’oie, et le train de derrière couvert d’une belle fourrure. Cet animal fréquente les marais, les ruisseaux ; il construit sa demeure en creusant profondément sur les bords de l’eau une véritable galerie souterraine.
L’oiseau que l’on appelle là « mount-building » ou « constructeur de monticules » est bien étrange aussi : il cache ses œufs sous un gros tas de feuilles sèches. La chaleur produite par la fermentation de ces feuilles suffit ensuite pour faire éclore les œufs. C’est au petit à se débrouiller pour sortir de sa prison et vivre sans l’aide de ses parents.
Nous autres, hirondelles, sommes plus heureuses.
IV
MORTE ET RESSUSCITÉE !
L’été qui suivit notre voyage en Australie nous avait ramenées en France.
Mais tandis que ma sœur s’était établie en Provence pour y faire souche d’une nouvelle famille, j’avais regagné Paris à tire d’aile, le cœur tout joyeux et les poumons dilatés autant par le bonheur que par l’air natal.
Enfin, après une année, je reprenais possession de mon bon vieux nid de famille, que je dus récrépir et remettre en état. Voilà bien l’austère Bibliothèque de Sainte-Geneviève ! Voilà bien, à sa place accoutumée, mon vénérable savant, toujours penché sur ses manuscrits ! Quelle joie profonde que celle de revoir le pays où l’on est née !
Mais aussi que de souvenirs tristes, en jetant un regard sur le passé, en interrogeant sa mémoire ! Ce nid, quand nous l’avions quitté, nous étions sept, et voici que j’y revenais seule!
Cet été passé à Paris fut assombri par mes réflexions mélancoliques. Mais le temps n’efface-t-il pas tout ? N’emporte-t-il pas également nos joies et nos douleurs ? D’ailleurs voici qu’à mon tour j’avais une jeune famille à élever ; le train des occupations quotidiennes, la nécessité d’approvisionner une nombreuse couvée, de satisfaire tous les petits becs tendus vers moi, avaient fini par distraire mon esprit. Puis mes jeunes hirondelles avaient fait le premier essai de leurs ailes, et l’automne arrivait à grands pas, lorsqu’un jour je fus victime d’une catastrophe qui devait avoir pour moi des suites bien étranges.
Au mois d’octobre, au moment où, par une accablante journée d’orage qui nous forçait à raser la terre afin de saisir les insectes dont nous nous nourrissons, j’étais au ras du sol, un cocher m’atteignit d’un coup de son fouet. Je fus précipitée dans la boue.
À partir de ce moment je perdis toute connaissance, tout souvenir de ce qui se passa. Il ne m’est plus resté que la notion, très vague, d’un long sommeil léthargique, sur une couchette chaude et moelleuse, dans une obscurité profonde.
Ce n’est que depuis que j’ai appris ce qui m’était arrivé, et comment, sans m’en douter ni le vouloir assurément, j’étais en train de passer la postérité.
Au mois de mai 1888 en effet, il paraît que je fus portée et présentée à la Société des naturalistes, à Paris ; l’histoire de mon accident et de ses suites fut expliquée à la docte assemblée. J’avais, dit-on (une fois jetée à terre par le fouet brutal du cocher), été recueillie par un enfant compatissant, qui m’avait lavée et enveloppée dans un rouleau d’ouate. Mon petit bienfaiteur m’avait ensuite déposée dans le fond de son tiroir ; puis, quelque partie de toupie ou de lawn-tennis l’ayant captivé, sans doute, il m’avait perdue de vue. Et ce n’est qu’au commencement du mois de mai 1888 que j’avais été retrouvée par hasard, au fond du tiroir, dans mon linceul d’ouate, vivante bien qu’endormie dans un sommeil léthargique. Il y avait sept mois que je dormais ainsi.
Oh ! que je voudrais pouvoir raconter les beaux rêves que j’ai faits pendant ce long sommeil ! Je revoyais les Alpes, l’Orient, l’Australie ! Je nageais dans la nue azurée ; le souffle du printemps enflait mes ailes. Parfois aussi je me sentais frappée de la cruelle lanière, et il me semblait que je tombais, tombais, sans pouvoir jamais m’arrêter dans ma chute.
Et me voici aujourd’hui célèbre par ma mort… et ma résurrection ! L’un des plus aimables savants contemporains de la race humaine a écrit à mon sujet : « Au mois d’octobre dernier, un cocher abattit d’un coup de son arme professionnelle l’intéressante créature en question. Précipitée dans la boue, elle ne put s’en dépêtrer ; un enfant la recueillit tout enrobée de fange.
Après l’avoir lavée, on l’enveloppa dans un rouleau d’ouate, et, l’un contenant l’autre, le tout fut déposé et oublié dans un tiroir.
On l’oublia tout l’hiver et bien au-delà, puisque c’est le mois dernier seulement que le paquet ayant par hasard été tiré de sa cachette, on découvrit qu’il contenait une hirondelle vivante, endormie depuis six à sept mois du sommeil léthargique.
Réveillée devant les membres de la Société des naturalistes, la charmante autant qu’utile petite bête a été rendue à la liberté. »
C’est mon étrange aventure qui m’a décidée à écrire ces courts mémoires.
J’ai pensé que ce récit, s’il était traduit en langage humain, pourrait intéresser les petits camarades du généreux écolier à qui je dois la vie, et aussi les savants qui m’ont examinée pendant mon sommeil léthargique, qui ont assisté à ma résurrection.
Grâce à eux, je vais pouvoir reprendre mon vol dans les cieux et chanter leurs louanges ; car nous aimons les homme, nous savons qu’ils n’ont pour nous que des sentiments d’amitié et de protection. Et c’est un poète de ce siècle et de mon pays qui nous a le plus magnifiquement chantées, quand il a dit de l’hirondelle :
Toi qui peux monter solitaire
Au ciel, sans gravir les sommets,
Et dans les vallons de la terre
Descendre sans tomber jamais :
Toi qui, sans te pencher au fleuve
Où nous ne puisons qu’à genoux,
Peux aller boire avant qu’il pleuve
Au nuage trop haut pour nous ;
Toi qui pars au déclin des roses
Et reviens au nid printanier,
Fidèle aux deux meilleures choses :
L’indépendance et le foyer !
SULLY-PRUDHOMME